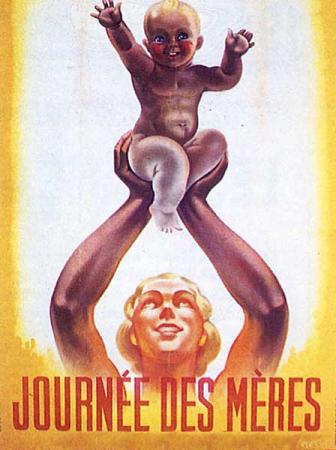A l'occasion de la sortie du Spécial Céline de La presse littéraire dirigée par le cher Joseph, voici mon propre article sur l'auteur de Mort à Crédit paru en juillet 2006 dans cette même Presse Littéraire, qui, en juillet 2006, était déjà consacrée à celui-ci.
A l'occasion de la sortie du Spécial Céline de La presse littéraire dirigée par le cher Joseph, voici mon propre article sur l'auteur de Mort à Crédit paru en juillet 2006 dans cette même Presse Littéraire, qui, en juillet 2006, était déjà consacrée à celui-ci.
« La torture a toujours déjà eu lieu ailleurs que dans l’écriture lorsque apparaît une écriture torturée. » Philippe Muray, Céline, page 89.
On écrit toujours après. Ca étonne les gens : « Mais puisque vous allez bien maintenant pourquoi diable ne parlez-vous que de suicide, de mort et d’enfance malheureuse dans vos livres ? » C’est sûr, pourquoi écrire torturé puisque l’on ne l’est plus ? Ce que les « gens » (c’est-à-dire les non-écrivants et nous allions dire avec un mépris littéraire de bon aloi « les heureux ») ne peuvent comprendre est que la souffrance ne s’exprime jamais quand elle est vécue. Oliver Twist rêve plus de Peter Pan que d’Oliver Twist. C’est lorsqu’on sera sorti de la souffrance, comme d’ailleurs de l’enfance, que l’on pourra parler d’elle. Et plus l’on sera heureux, plus l’on sera susceptible d’exprimer les peines passées. A contrario, ce sont ceux qui n’ont jamais digéré leur misère qui se satisfont d’œuvres « positives » et d’espoir bon marché. Le monde idéal est un refuge pour dépressifs. Il faut être en parfaite santé pour appréhender la tragédie du monde. Plus un auteur est cruel et impitoyable, plus il est dans la force et la joie. Et c’est lorsqu’il se met à parler d’utopie, d’égalité et de bonheur qu’il prouve qu’il va mal.
Probité de Céline.
Céline n’a pu écrire le Voyage au bout de la nuit qu’après en être revenu. Dans les tranchées, on fait tout pour se persuader du bien-fondé de la cause, on croit d’ailleurs que la guerre forge un homme, et si l’on écrit à ce moment-là, c’est pour rassurer ses parents. C’est après que l’on dira que la guerre est « dégueulasse » parce que l’homme est « dégueulasse » ou parce que la vie est « dégueulasse ». Encore que pour Céline, la guerre soit moins pire que l’enfance – vous ne voulez pas l’entendre, braves gens, mais les taloches qu’on a reçues gamin ont fait plus mal et sont plus difficiles à avouer qu’un obus qui nous a arraché un bras. Le père qui tabasse son fils, la mère qui hurle après lui « qu’il va la faire mourir » sont des souvenirs plus traumatisants qu’une bombe qui explose et tue trois camarades. Que Céline ait eu, comme tout prolétaire, une enfance brutale faite de gifles et de brimades (quoique non dénuée de cette rude affection qui ne prend en compte que la survie de l’enfant et se fiche de sa sensibilité) a fait que Mort à crédit ne pouvait venir qu’après le Voyage. Il lui fut plus aisé de raconter la tragédie du monde moderne avant de raconter la tragédie éternelle de l’ enfance. Il lui fallut aussi attendre que son père meure pour le faire[1] - et prendre un autre nom de surcroît. Le premier mot de l’écrivain est toujours le pseudonyme – comme son premier acte est toujours un parricide, ou dans le cas de Louis-Ferdinand Destouches, un matricide. En choisissant de signer « Céline », soit le prénom de sa grand-mère maternelle, il faisait d'une pierre deux coups - renier son père et annuler sa mère. Qu’avait-elle de plus que sa mère cette grand-mère ? « Je peux pas dire qu’elle était tendre, ni affectueuse, écrit-il d’elle dans Mort à crédit, mais elle parlait pas beaucoup et ça c’est déjà énorme ; et puis, elle ne m’a jamais giflé ! »[2]. Bien vu. Les parents, c’était coups et parlotte, la grand-mère, c’était celle qui se taisait et qui ne frappait pas. Céline, écrivain, aura la probité de cette grand-mère. Si violente soit-elle, son œuvre romanesque n’est jamais un discours - c’est-à-dire une leçon de morale qui accuse, juge et condamne. Surtout, elle ne « tape » sur personne. Certes, le genre humain n’est pas à la fête, mais ce pessimisme romanesque n’est en rien discriminatoire. Tout le monde fait partie du Guignol’s band sans que nul ne soit chargé d’en être le bouc émissaire. D’ailleurs, Céline charge moins ses personnages qu’il ne les prend en pitié – de cette grande pitié chère à Schopenhauer devant la douleur du monde. C’est un style qui ne fait que rapporter les hurlements des vivants mais sans jamais chercher à faire passer un « message » moral ou idéologique. On souffre chez Céline, mais on n’accuse personne. A la limite peut-on dire que c’est la vie qui est mauvaise et qui fait de nous ses victimes mais l’individu, lui, reste sauf. Du Voyage à Rigodon, tout est sombre mais tout est probe.
Ecrire, c’est donc raconter la vie sans trouver de coupable. C’est témoigner du Calvaire sans en rendre responsables ni Juifs ni Romains. C’est énoncer les choses sans dénoncer les personnes ni surtout s’imposer soi-même. Lorsque le grand écrivain se met en scène, ce n’est jamais pour occuper abusivement celle-ci. Il s’agit moins pour lui de raconter ce qu’il vit, comme tout le monde le fait (et dans ce cas-là, écrire est vain), que de raconter ce que la vie vit de lui. Saisir les flux qui passent en nous, devenir l’antenne du réel, se faire tout petit dans un monde trop grand, tel est le grand style. Comme n’importe quel autre de ses personnages, Céline tend, selon la recommandation que Kafka se faisait à lui-même dans le célèbre fragment « Résolutions », à devenir un « revenant » de la vie. « Il est de meilleur conseil de tout accepter, de se comporter comme une masse inerte, même si l’on se sent comme emporté par le vent, de ne se laisser entraîner à aucun pas inutile, de regarder les autres avec un regard vide d’animal, de n’éprouver aucun remords, bref, d’écraser de ses propres mains le dernier fantôme de vie qui subsiste encore, autrement dit, d’ajouter encore au silence de la tombe et de ne rien laisser exister en dehors de lui. » La « résolution » littéraire est donc bien d’écrire ce qui se passe sans s’expliquer pourquoi (c’est-à-dire « à cause de… »), d’accepter animalement la réalité la plus cruelle, sans jamais y apposer son jugement moral, et de fait, ne pas craindre de devenir « illisible ». Cette « illisibilité », qui n’est rien d’autre qu’une suspension du jugement, voire une absence de l’idéologie, traverse de part en part les romans de Céline, atteignant le sublime dans la trilogie allemande.
 Le racisme lisible.
Le racisme lisible.
Au contraire, rien de plus « lisible » (et par là même rien de plus facile à écrire pour l’auteur – donc rien de moins écrit) que les fameux pamphlets. Dans ces derniers, Céline cherche moins à « écrire la vie » qu’à « dire » ce qu’il pense d’elle, autrement dit à se départir de l’innocence cruelle de celle-ci et qui faisait le génie de son écriture à lui. Le roman prenait les choses telles qu’elles sont, le pamphlet propose les choses telles qu’elles devraient être – et par conséquent, l’écrivain devenu pamphlétaire se met à diviser la réalité – l’humanité ! - mettant d’un côté ce qui ne va pas, de l’autre, ce qui pourrait aller mieux, d’un côté, les coupables, de l’autre, les victimes, ici, les impurs, là les purs. L’ « écriture pamphlétaire » relève du calcul, du découpage, et risque toujours de virer à la boucherie. Le style ne vise plus la somme des choses mais la soustraction du négatif dans le positif.
Evidemment, fort de sa syntaxe unique et de sa puissante verve, Céline peut faire semblant d’écrire mais cette écriture n’est plus qu’un procédé destiné à exprimer non plus le « silence de la tombe », mais le bruit de l’opinion mêlé à la fureur du tribunal. Le Calvaire apparaît dès lors moins important que ceux dont on présume qu’ils en sont la cause. Les revenants deviennent des bouc émissaires qu’il faut lyncher. Au lieu de prier l’homme-dieu crucifié, on se met à chercher les crucifieurs pour les crucifier à leur tour. Comme le rappelle Philippe Muray dans son Céline, essai canonique dont est directement inspiré cet article, « dans les pamphlets, c’est au service du refoulement sauvage des revenants qu’il met toute la puissance de la plus-value de son écriture. D’où il devient aussitôt éminemment lisible. »[3] Lisible, c’est-à-dire, en langage célinien, raciste. La jouissance littéraire n’est plus celle, grandiose, d’un Verbe qui s’invente et s’élève au-dessus de la « langue de la tribu » mais celle, mauvaise, basse, libidinale, qui rassemble tout le groupe. Le Verbe n’est plus celui de l’incarnation du singulier mais celui de « l’incarnement » du collectif. Ce n’est plus un corps qui parle, c’est la viande de la meute qui beugle. Voyage au bout de la nuit embrassait le monde, Bagatelles pour un massacre dresse les communautés les unes contre les autres.
Que s’est-il passé ? Au fond, Céline n’a pu rester toute sa vie un romancier, c’est-à-dire cet être héroïquement libre qui arrive à transposer la réalité sans jamais prendre parti et qui à bien des égards est un garant lucide de la réalité humaine. « La littérature est un savoir sur la nullité du monde », écrit Muray[4]. Cependant, certaines blessures ont pu ne jamais se cicatriser et se mettre à polluer tout son être – en langage psy, à devenir des névroses, c’est-à-dire des souffrances dont on ne se rend plus compte qu’elles le sont et qui se sont transformées en ressentiments avant de ressurgir en haines. Le noble acte de créer est devenu alors une déjection.
Ainsi, le pamphlet change la donne. La vie y est décrite de manière toujours aussi horrible mais cette fois-ci pour des raisons précises. L’horreur n’est plus existentielle, elle est sociale, politique, économique, historique, ethnique. Autrement dit, elle est évitable car il suffit de changer le système ou les gens du système ou ceux dont on se persuade qu’ils en profitent plus que d’autres pour que, croit-on, le monde redevienne plus juste et la vie plus belle. « On sait, explique Muray, que c’est du refoulement de toute négativité – mort, désir, répétition, rythmes, érotisme, rire – que naît généralement l’adhésion mortifère à un idéal du moi politique, à un totalitarisme et, par-dessus tout, à un racisme. »[5]. Le racisme n’est en effet rien d’autre qu’une perte de sa propre négativité en l’autre et dont l’aval, voire l’anal, est un espoir que cet autre soit déclaré coupable de tous nos maux et puni. Le raciste rêve d’un monde entièrement positif où tout conflit, soit toute différence, serait anthropologiquement absent. A ses côtés, l’antisémite, non moins positif, est celui qui conçoit le monde hors de toute cette transcendance culpabilisatrice qu’ont imposée, pour son malheur, les Juifs à l’humanité. Avec leur invention du Dieu monothéiste et de toutes ses catégories empoisonneuses d’âmes, Lois, Commandements, Péché, Pardon, Miséricorde, c’en est fini de l’innocence sauvage d’antan et de son grand rire dionysiaque. « Les Juifs ont inventé la conscience », dira non sans raison Adolf Hitler, et comme le rappellera George Steiner. Bref, si nous souffrons, c’est à cause précisément de ceux-là qui sont partout, qui ont pris notre place dans la hiérarchie sociale, qui ont spolié nos biens, se sont enrichis sur notre dos, et qui par-dessus le marché, ont créé le dieu le plus impitoyable tout en crucifiant le nôtre.[6]
L’antisémitisme est un anti-christianisme.
La singularité de l’antisémitisme célinien vient du fait que celui-ci jaillit sous la plume d’un auteur qu’on aurait cru blindé contre la tentation positive. Comme le dit Philippe Muray, « Le négatif occupant intégralement les romans, ce qui fait retour dans les pamphlets c’est le positif, du moins le sien, qui recoupe d’ailleurs largement celui de la collectivité d’alors. » [7] Une communauté de petits-bourgeois positivistes plutôt antichrétiens qui croient au progrès et à la Science, celle-ci dont Céline disait dans l’un de ses premiers écrits qu’il attendait le jour « où elle se suffira à elle-même et où elle créera la Vie. »[8] Une vie parfaite, toute positive, fraternelle et égalitaire, où le travail rend heureux et où l’amour est une question sociale plutôt qu’intime. En attendant ce grand jour, il s’agit d’extirper ce qui va mal chez nous, et d’abord cette propension religieuse à souffrir – ce négatif que les Juifs (et les Chrétiens) ont placé au cœur de notre être. Pour Céline comme pour ses frères de pensée, « l’enjeu est de déloger définitivement ce que les religions dites judéo-chrétiennes maintiennent tant bien que mal : la dimension négative. Si la vérité du langage est chrétienne, comme l’affirmait Georges Bataille, il est évident que les pamphlets constituent l’exemplaire tentative de se passer de cette vérité, c’est-à-dire aussi – par le symptôme de la rapidité d’écriture – de se passer du langage. »[9] A ce propos, remarquons que dans l’esprit de Céline, l’anti-christianisme est la suite logique de l’antisémitisme. Mais comme il est plus facile dans cette France des années trente de s’en prendre aux Juifs qu’aux Catholiques (aujourd’hui, c’est le contraire), Céline se lâche contre les premiers. Pour autant, l’Eglise romaine reste dans son collimateur : « La religion christianique ? La judéo-talmudo-communiste ? Un gang ! Les Apôtres ? Tous Juifs ! Tous gangsters ! Le premier rang ? L’Eglise ! La première racket ? Le premier commissariat du peuple ? L’Eglise ! Pierre ! Un Al Capone du Cantique ! Un Trotski pour moujiks romains ! » lit-on dans L’école des cadavres.[10] Des années plus tard, dans Rigodon, il confirmera sa haine de « la religion à petit Jésus » : « Il n’y qu’une seule religion : catholique, protestante ou juive… succursales de la boutique « au petit Jésus »… qu’elles se chamaillent s’entre-tripent ?…. vétilles ?… corridas saignantes pour badauds ! Le grand boulot le seul le vrai leur profond accord… abrutir, détruire la race blanche. » Moïse et Jésus contre la race blanche ! La voilà la guerre « célinienne » par excellence. En fait, et comme le remarque Muray, pour Céline, c’est dans la Bible que l’on a dit pour la première fois, et bien avant la génétique aujourd’hui, que les races n’existent pas et qu’il n’y a que des métissages. Le Verbe s’est fait chair, mais c’est une chair mélangée, aussi blanche que noire ou que jaune ! Pas d’exclusivité aryenne ! « Tous issus de la Bible, absolument total d’accord qu’on est que blancs, viandes à métissages, tournés noirs, jaunes, et puis esclaves, et puis soldouilles et puis charniers… » [11]écrit encore Céline dans son dernier livre. C’est pourquoi c’est au Verbe qu’il faut s’en prendre, cet odieux Verbe monothéiste et anti-racialiste qui nous a créés impurs (mélangés) plutôt que purs - le racisme n’étant, comme on sait, rien d’autre qu’un fantasme de pureté.
Voici donc un écrivain qui a inventé dans ses romans sans doute l’une des plus belles langues de douleur du monde qui soient et qui dans ses pamphlets se met à s’acharner contre celle-ci. Car c’est à la littérature (et la sienne !) autant qu’aux Juifs que Céline s’en prend dans Bagatelles pour un massacre, L’école des cadavres et les Beaux Draps. Si, comme le soutient Muray, le grand art est celui qui se fait avec le mal, le petit art se fait avec le bien. Il est le lieu des bons sentiments et aussi du délassement moral. Dans ses pamphlets, Céline, pour une fois, s’est reposé. L’épuisante tragédie du monde mise en suspens, les revenants abandonnés, il a pu enfin cesser d’être écrivain pour revenir à sa première passion sociale et professionnelle : la médecine. Or, si l’acte de soigner le corps des hommes reste sans doute le plus beau et le plus noble métier du monde, celui de soigner les esprits apparaît comme le plus équivoque. Car s’il existe des écrivains à la Walt Whitman qui embellissent réellement le monde, la plupart des écrivains « positifs » censés rendre ce dernier plus heureux se sont vite révélés des charlatans – c’est-à-dire des idéologues.
Utopie, philanthropie, médecine, et antisémitisme.
On sait grâce à Jacques Derrida combien le pharmacon est un palliatif autant qu’un bouc émissaire. Ce qui soigne, c’est ce(lui) dont on se débarrasse. Ainsi la mauvaise littérature est celle qui nous drogue au sacrifice des autres. C’est pourquoi, loin de venir la soigner, le grand écrivain, qui est le contraire d’un anesthésiant providentiel ou d’un embaumeur officiel, n’est là que pour rendre malade l’humanité. De Dante à Dostoïevski, la littérature n’eut cure que de charcuter les âmes, de ne jamais laisser se refermer les plaies, au contraire, de les élargir au maximum et de mettre du sel dedans - c’est-à-dire de ne jamais laisser en paix quiconque ose être satisfait de sa petite vie et qui se faisant oublie la tragédie du monde, soit la douleur de l’autre. L’ennemi de l’écrivain n’est jamais le Juif ou le pédé, ni même le criminel, mais bien « l’homme sain » qui ne veut surtout pas être mêlé à la douloureuse complexité du monde, qui se borne à veiller sur ses intérêts et qui refuse de toute sa ruse d’homme rustre, d’instinct canin, la conscience blessée de l’homme universel. « L’homme sain est l’homme le plus terre-à-terre, et par conséquent il doit vivre de la vie d’ici-bas, pour sa satisfaction et le bon ordre », dit Dostoïevski par la bouche de Svidrigailov dans Crime et châtiment. Le raciste est cet homme sain au carré. Non seulement la souffrance de l’autre n’entre pas dans ses catégories mentales mais encore il considère que c’est l’autre qui est coupable de sa souffrance à lui. Drogue suprême, l’antisémitisme « dialectise » et inverse la relation de la victime et du bourreau. Ecrire contre le juif, c’est se soulager de toute sa peine et croire que l’on va retrouver l’âge d’or de l’humanité.
C’est ce que les amis du genre humain, les idéologues, demandent d’ailleurs à l’écrivain – que la féerie ne soit pas remise pour une autre fois ! Que la « petite musique » devienne l’hymne du nouveau monde ! Que le grand style se fasse social ! A quoi bon en effet désespérer Billancourt ou Cro-Magnon ? Il faut relire ce que certains critiques « typiques » de l’époque ont pu reprocher à Céline : sa noirceur foncière irrécupérable pour un socialiste, son désespoir absolu inapte à toute révolution nationale ou prolétarienne. « Il a mis en question et traîné dans l’ordure tout ce que l’existence humaine pouvait présenter de valeurs positives », a dit de lui Bernard Payr, général SS et Gauleiter de l’édition sous le troisième Reich. « Il se réfugie dans ses visions de cauchemar pour éviter de répondre à la question : que faire ? », rajoute le critique soviétique Anissimov[12]. Effectivement, Céline romancier est ennemi du genre humain. On ne peut rien faire avec lui. Au moins, avec ses pamphlets, pourra-t-il se retrouver du côté de ceux qui rêvent du paradis sur terre et en font un enfer.
Il ne faut donc pas se leurrer : si l’antisémitisme célinien représente le pire de son œuvre, il n’en est pas moins le versant positif, humaniste et médical. « Est déjà antisémite quiconque se sent médecin devant la littérature », [13]dit Muray avec justesse. Le Céline médecin est le Céline pamphlétaire, raciste, charlatan – celui qui ne supporte plus l’horrible. Encore Muray : « L’horrible, finalement, lui a fait horreur. Alors, par sursauts, il s’est mis à penser contradictoirement la mort comme une maladie de la vie, comme une maladie dont on pouvait guérir. Il s’est remis, en somme, à penser comme tout le monde, et c’est cette idée de guérison qu’il a tenté de fonder dans son élaboration de l’antisémitisme. Or, l’espoir de guérir est la maladie de l’homme ainsi que le disait Kafka. »[14] Après avoir rendu malade l’humanité par ses romans, Céline a voulu la soigner par ses pamphlets. L’exercice était d’autant plus aisé qu’il lui suffisait de mettre ses « acquis » stylistiques au profit de ses opinions. D’où la vitesse avec laquelle il écrivit les pamphlets, lui qui mettait, comme il le répétait en interviews, des années à composer un roman. Autant créer une nouvelle langue était un travail prométhéen, autant utiliser celle-ci pour servir ses démons était un jeu d’enfant.
L’enfant, justement – l’être créatif et/ou mimétique par excellence. L’enfant qui invente une langue, un monde, un style, c’est l’enfant romanesque, imaginatif, sensible. Mais l’enfant qui répète ce qu’il a entendu beugler chez lui, qui commence à « penser » comme papa-maman, qui se fait le politicien de la cour de récré comme son père est le politicien du bar d’à côté, qui se plaint aussi, comme sa mère, de l’injustice, de la vie chère, de la salissure, c’est l’enfant manipulé, aliéné, idéologue, c’est l’enfant des pamphlets.
L’on n’a pas assez dit que le pamphlet était le genre filial par excellence. Le mépris des autres, la haine de l’étranger parce qu’il a pris notre travail ou du franc-maçon parce qu’il a pris notre place ou tout simplement du patron parce que c’est un « enfoiré de riche» sans oublier le Juif qui est tout ça à la fois. Les invectives contre eux, nous en avons (presque) tous entendu dans la bouche de nos pères et mères. La famille est si souvent ce lieu où l’on « s’aime » contre le monde entier que l’on déteste. C’est quand Céline affirme son racisme qu’il renoue le lien avec son milieu. L’abjection est ombilicale. La langue maternelle est raciste. « Jamais Céline n’est plus fils de sa maman que dans les pamphlets »[15] , dit encore Muray. C’est l’anus de sa mère qui parle par sa bouche quand il écrit Bagatelles.
Et en effet, les pamphlets relèvent de l’aberration xénophobe comme de l’utopie sociale. Le délire de persécution va de pair avec les plans d’un bonheur communautaire futur. Il faut relire ces pages où Céline parle de résorber le chômage : « Je nationalise les Banques, les mines, les chemins de fer, les assurances, l’Industrie, les grands magasins… C’est tout ? Je kolkozifie l’agriculture à partir de tant d’hectares, les lignes de navigation (…) Et ceux qui veulent pas travailler ? Je les fous en prison ! », et propose rien de moins que…les trente-cinq heures : « …il me semble à tout bien peser que 35 heures c’est maximum par bonhomme et par semaine au tarabustage des usines, sans tourner complètement bourrique », ou une sorte de salaire maximum à l’instar des pays communistes : « Je décrète salaire national 100 francs par jour maximum et les revenus tout pareillement pour les bourgeois qui restent encore, bribes de rentes, ainsi je n’affame personne en attendant l’ordre nouveau. Personne ne peut gagner plus de cent balles, dictateur compris, salaire national, la livre nationale. Tout le surplus passe à l’Etat », le tout à travers une politique social démocrate : « Faut pas du grand communisme, ils comprendraient rien, il faut du communisme Labiche, du communisme petit bourgeois, avec le pavillon permis, héréditaire et bien de famille, insaisissable dans tous les cas, et le jardin de cinq cents mètres, et l’assurance contre tout. », sans oublier l’Education nationale qu’il repense façon 68 : « Rénovez l’école ! (…) Tout reprendre par l’école, rien ne peut plus se faire sans l’école, hors l’école. Ordonner, choyer, faire éclore une école heureuse, agréable, joyeuse, fructueuse à l’âme enfin, non point morne et ratatinière, constipante, gercée et maléfique. (…) L’école est un monde nouveau qui ne demande qu’à paraître, parfaitement féerique ! »[16] Bref, le pamphlet fait dans la philanthropie. Sans doute est-ce la raison pour laquelle Céline pose encore et toujours des « problème » Ce que l’on ne supporte pas est que son antisémitisme insoutenable aille de pair avec son indéniable humanisme, pire : que l’un soit garant de l’autre. Si Céline avait été « le salaud idéal » à la Robert Brasillach, soit bourgeois, réac et facho, il aurait été beaucoup plus facile d’en finir avec lui. Hélas pour les humanistes, Céline est à bien des égards cette « voix du peuple » tellement prisée à gauche et que l’on a si rarement entendue en littérature mais qui est aussi celle des pamphlets, eux-mêmes constituant les preuves les plus accablantes de la tentation utopique socialiste. « En quoi, écrit Muray, il [Céline] est bien toujours la gaffe, l’énorme gaffe de la communauté, le lapsus horrible qui lui a un jour échappé. »[17] Irrécupérable génie qui a révélé dans toute son horreur l’innocence du peuple ou dans toute son innocence l’horreur du peuple ! Impensable dans une démocratie où le peuple est normalement sacré, Céline reste celui qui a pensé comme tout le monde et écrit comme nul autre, démontrant à son corps défendant que c’est toujours lorsque le Verbe tombe dans l’opinion, lorsque la langue devient tribale, lorsque que le style se fait social, que la souillure a lieu.
Au fond, comme le conclut Muray, « pour la communauté qui panique, les pamphlets sont bien moins « méchants », en effet, que les romans. »[18] Les pamphlets ont rassuré un monde qui avait été pris à partie par les romans. De Mort à Crédit à Bagatelles pour un massacre, on passait de l’ombre à la lumière. Avec quelques réformes et quelques aménagements, la tragédie du monde ne pouvait être qu’un mauvais souvenir. On pouvait enfin « nommer » le négatif et même si cette nomination était précisément l’innommable, la vie redevenait vivable. Les braves gens étaient saufs. Et peut-être allaient-ils moins baffer leurs enfants.
(Cet article est paru dans le premier Hors Série, "Spécial Céline" de La presse littéraire de juillet-août 2006)
[1] Proust aussi dut attendre la mort de sa mère avant de commencer la Recherche. Si l’écriture vient toujours de la mère, comme le disait Nabe dans Au régal des Vermines, c’est toujours pour se retourner contre elle. Ecrire, c’est garder la vie de celle qui nous l’a donnée et qui veut si souvent la reprendre (castration). On sait que Céline, quand il publia Mort à crédit, interdit à sa mère de le lire.
[2] Mort à crédit in « Céline, Romans I », la Pléiade, Gallimard, 1981, p. 560-561.
[3] Céline, Philippe Muray, chapitre cinq « Divin, trop divin » , Tel Gallimard, p. 142.
[4] Ibid ; p. 169.
[5] Ibid ; p. 143.
[6] Bien entendu, pour un chrétien orthodoxe, le Christianisme est l’aboutissement et l’apothéose du Judaïsme sauf pour les chrétiens antisémites qui ne peuvent admettre les origines juives de Jésus et se consolent en en imaginant des aryennes. Le fantasme d’un Christ celtique est l’un des plus courus d’aujourd’hui.
[9] Ibid ; p. 144.
[10] Cité par Muray, p. 175.
[11] Cité par Muray, p. 177.
[12] Cité par Muray, p. 101-102.
[16] Tous ces extraits, cités par Muray, p.171-173.
[17] Ibid ; p. 174.
[18] Ibid ; p. 187.